| 3. Les Kongo, semblables et différents: des témoins de l'histoire |
 |
Représentation stylisée de danseurs et pecussionniste traditionnels Kôngo par le plasticien Simon N'sondé.
(© Simon N'sondé)
|
Ils représentent certainement le peuple d’Afrique centrale le plus étudié, depuis les premiers contacts avec les Portugais à la fin du XVème siècle. Leur nom, Kôngo, renvoie à une multitude de significations qui se rattachent d’abord à un territoire qu’ils appellent tous en kikôngo, toutes variantes régionales confondues, nsì yà Kôngo, «le pays de Kôngo» ou encore Kongo dià Ntotila, «le paysdu Ntotila», c’est dire «le pays du Roi». D’après de nombreuses traditions orales, la dénomination Kôngo proviendrait surtout de l’expression ku ngò , «pays de la panthère». En effet, ce félin joue le rôle d’animal totémique pour de nombreux lignages et clans kôngo car il symbolise le pouvoir, la force et le courage. C’est notamment le cas chez les Bissi Mbêmbé, clan sûndi du district de Kindamba, dans la région du Pool au Congo-Brazzaville (iv). Au-delà, on retrouve ce symbole parmi les attributs matériels (collier, couvre-chef, bracelet) (v) des détenteurs de fonctions politiques chez d’autres peuples bantous, et même pour beaucoup de dirigeants actuels. Selon d’autres traditions, le terme kôngo désignerait un lieu de marché. Dans ces lieux, sources de richesses dans l’Afrique précoloniale, se déroulaient les principaux échanges et ils conservent encore aujourd’hui une fonction économique importante, avec peu d’équivalent ailleurs dans le monde.
(Illustration musicale 1: “Nsusu yi kubidi” - A.B. Lolita, Nsusu yi kubidi)

Le palais royal de San Salvador.
Notez la forme en labyrinthe qui rappelle les spirales de l'escargot, symbole Kôngo des origines du monde.
(© Archives des Capucins)
|
Bien d’autres interprétations plus anecdotiques existent, mais ces deux-là résument des aspects essentiels de la réalité politique, sociale et économique kôngo : leur capacité ancienne à contrôler très tôt un territoire, à y organiser des structures étatiques étendues – au-delà du village, du groupe de villages et de la région – sous formes de royaumes, au moins dès le XIIIe siècle pour le Kongo. A la fin du XVème, ce dernier exerce d’ailleurs directement sa tutelle sur tout le territoire et les peuples de langue kôngo compris entre l’actuelle capitale angolaise de Luanda au sud, les capitales jumelles de Brazzaville et Kinshasa à l’est, la rivière Kwango au sud-est, et indirectement la région de Pointe-Noire et de Mayumba à l’ouest. Sous le contrôle de l’état du Loango, cette dernière région reconnaît encore la primauté spirituelle du Mani-Kongo, « Roi du Kongo », mais échappe déjà à son influence politique réelle. Plus tard, les états voisins du Kakongo et du Ngoyo – dans l’actuelle province angolaise du Cabinda – suivent la même évolution. Ce phénomène d’émancipation des espaces kongo « périphériques » va s’accentuer au cours du XVIème avec le développement de la traite négrière portugaise vers 1540 et débouche sur le démembrement du Kongo au XVIIème . Le pays mbûndu devient Angola, colonie sous tutelle portugaise tandis que la région littorale du Soyo acquiert son indépendance politique comme principauté.

"Palais" de chef.
Notez encore la forme en labyrinthe qui rappelle les spirales de l'escargot, symbole Kôngo des origines du monde.
(© Archives des Capucins)
|
Les travaux des linguistes, déjà anciens, sur les langues bantoues retiennent entre 30 et 50 variantes régionales que l’on peut classer sous le vocable kikôngo et se situent toutes à l’intérieur du territoire évoquée précédemment (vi). De cet ensemble, il faut souligner la forte homogénéité linguistique – l’intercompréhension immédiate est facile tant le lexique et les structures sont identiques – malgré les différences de prononciation. Une quinzaine de parlers se dégagent néanmoins avec un nombre de locuteurs conséquent, d’au moins plusieurs centaines de locuteurs et un certain dynamisme socio-linguistique. On peut citer, en partant du littoral atlantique vers l’est, les Vìlì (région de Pointe- Noire), les Yombé, les Wòyò (Cabinda) et les Solongo (région angolaise de Soyo), les Sûndi, les Lâri(région du Pool), les Bêmbé, les Kamba, les Dôndo, (vallée du Niari au Congo-Brazzaville), les `Ntandu, les Ndibu, les Mpangu, les Manianga (région du Bas-Congo au Congo Kinshasa) et enfin les Kôngo proprement dits dans les deux Congo et au nord de l’Angola (province de Uige). Outre la langue qu’elles partagent, toutes ces communautés régionales revendiquent une origine commune, sans exception : celle du Kongo dià Ntotila, l’ancien royaume du Congo.

Les Etats de langue Koongo au 18ème siècle.Carte extraite de, Langues, culture et histoire koongo aux XVIIème et XVIIIème siècles par Jean de Dieu N'sondé.
(© Jean N'sondé)
|
A cette unité linguistique, il faut ajouter une organisation sociale identique fondée sur le lignage maternel –équivalent grosso modo à la famille élargie - le kândà, comme premier niveau d’appartenance et d’exercice de toutes les activités et fonctions, qu’elles soient « familiales », religieuses, économiques, juridiques ou politiques. En effet, le kàndà dispose d’une propriété foncière indivise que les membres exploitent en usufruit en tant qu’ayant-droits et sur laquelle des « étrangers » peuvent s’établir pour pratiquer l’agriculture, la chasse , la pêche ou le commerce en échange d’une redevance. L’aîné en âge du groupe, mùkùlùntù, gére donc toutes ces activités en tant qu'autorité judiciaire, économique et politique locale, mfumu kânda. Selon les contextes, les circonstances et les alliances, son influence peut s’étendre à d’autres lignages apparentées qui font alors de lui un mfumu`nsì, « un chef de terre » reconnu par l’ensemble d’une région. Ainsi, cette construction décentralisée et pyramidale à la fois permettait au Ntotila ou Mani-Kongo, « Roi du Kongo » de n’être d’abord qu’un chef de lignage parmi d’autres mais reconnu par eux.
En dehors de ces relations sociales, économiques et politiques, la croyance aux esprits des ancêtres défunts et l’allégeance à ceux-ci constitue le lien sacré qui soude de manière indéfectible les membres du lignage kongo. Les activités humaines se déroulent sous la tutelle, la protection ou la sanction des bîba, les « esprits invisibles » de membres défunts du lignage. Le chef de ce dernier sert également de premier intermédiaire avec les ancêtres afin de garantir non seulement l’intégrité physique et morale du groupe, mais aussi sa prospérité. En cas de dysfonctionnement plus important, on fait appel au `ngàngà, expert ès monde invisible, tout à la fois médecin, psychologue, botaniste, philosophe et conseiller spirituel.
(Illustration musicale 2: “Mubondo” - Michel Rafa / Ballet Théatre Lemba, Musiques-chants traditionnels du Congo)
 Musiciens kôngo (dessin portugais, c. 1670)
Musiciens kôngo (dessin portugais, c. 1670)
|
Au cours des siècles, les diverses composantes du groupe kôngo ont connu des évolutions différentes, en fonction de leur localisation géographique, du contexte économique et politique général et surtout du niveau d’intégration aux flux du commerce négrier. Ainsi, on peut schématiquement opposer la transformation des sociétés côtières - du Loango au nord au pays mbundu au sud, en passant par le Cabinda – à la relative stabilité des groupes de « l’intérieur » tels que les Sûndi, voire les `Ntandu ou les Mpangu. Le commerce négrier représente donc, de manière durable, le phénomène le plus marquant dans cette région d’Afrique par son impact démographique, économique et politique direct. Sa précocité et sa longue durée (vii)
a amplifié son impact déstructurant dans ces différents domaines, mais il est plus ambigu et contrasté sur le plan socio- culturel (viii)
.
Illustration vidéo 1 (youtube): Le groupe "Les tambours de Brazza" à Bastille (Paris)
|

.jpg)


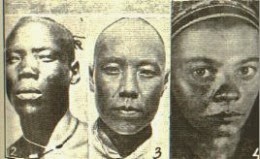
0 Commentaires